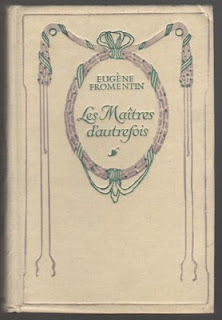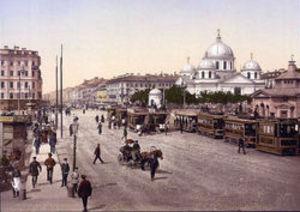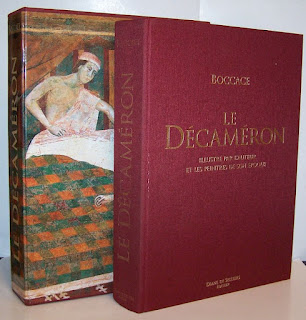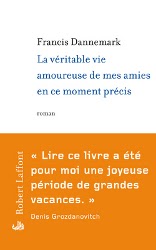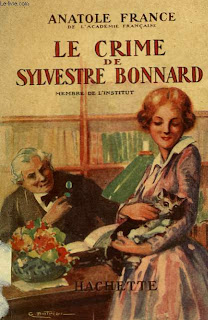Giulio-Enrico
Pisani
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek Luxembourg, 20.10.2012
Gerd Marx : hyperréalisme,
abstraction, ou
étincelle qui jaillit, là
où les extrêmes se touchent ?
L’année 1952, qui vit la
naissance de l’architecte d’intérieur et artiste photographe Gerd Marx, fut un
millésime significatif pour les deux disciplines qui marqueront son existence:
la photographie et l’architecture d’intérieur.
Ce fut en effet cette année là, que Charles-Édouard
Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, acheva la Cité radieuse de Marseille,
réalisa à Chandigarh (Inde) la Haute Cour
Aussi libre que peut l’être un
enfant par l’épanouissement de sa curiosité et un adolescent dans sa soif
d’exploration, il découvrit grâce à la photographie, avec ses appareils box
6x6, puis Rolleiflex 6x6, Minolta reflex et autres Canon, tout un monde imagé,
dont il parvenait à s’approprier des aspects insoupçonnés. Il fut certes obligé, une fois adulte, donc
face aux exigences de la vie, de limiter grandement sa créativité aux exigences
de sa profession d’architecte d’intérieur.
Mais le genre de photo qu’exigeait celle-ci, pratiquée avec une Mamiya
645 format 4,5x6 à objectifs interchangeables (shift pour la photo
d’architecture), ne chassa chez lui jamais tout à fait la photo violon
d’Ingres, la photographie tous azimuts, la photo passion. Pleinement retrouver sa magie à la fin de sa
carrière professionnelle, ne donna par conséquent aucun mal au désormais jeune
retraité Gerd Marx (je doute d’ailleurs qu’il ne l’eût jamais perdue) un demi
siècle plus tard. La faire triompher aux
cimaises de la Galerie
Michel Miltgen,[1]
à l’occasion de sa première exposition photographique «libre» se fit du même
élan.
Oui, libre! Défi réussi; n’eût-on pas, en effet, pu
s’attendre à ce que Gerd Marx profite et nous fasse profiter de sa longue expérience
de la photo architecturale, des jeux d’angles et de lignes droites ou courbes, de
perspectives, espaces, vides et volumes qu’il contribue à créer et à aménager
et dont il maîtrise les harmonies depuis quatre décades? Mais non, loin de se flatter de l’acquis, le
libre artiste, qu’il est certain d’être, sait devoir se mettre en danger et, afin
de retrouver les élans de sa prime jeunesse, devoir accepter les
questionnements, risques et incertitudes de l’art. Aussi, est-ce en artiste débutant, pour ainsi
dire en jeune créateur, que ce sexagénaire nous convie à sa première exposition,
où il s’expose du même coup à une critique dont il sait bien que l’approbation,
voire l’indulgence, qu’elle soit des experts, des critiques d’art, des amateurs
éclairés, ou de simples curieux, n’est jamais acquise.
Il m’est évidemment impossible
de présumer de l’accueil que feront les médias, les visiteurs et d’éventuels
acheteurs à ses splendides macrophotographies grand format de structures aussi
fascinantes qu’ignorées par l’oeil ordinaire de ces êtres pressés et
observateurs superficiels que nous sommes presque tous. Combien parmi nous s’arrêtent-ils en effet
pour admirer un clou rouillé, un morceau de bois pourri, une chaîne qui
n’enchaîne plus que sa propre usure? Et
qui songerait à admirer une structure mal couverte de peinture écaillée pour découvrir
dans la quasi-abstraction de cet étrange maculage – je pense à «Close-up 1» – une mer démontée, où un
vortex, tornade ou terrible maelström risque d’engloutir un archipel en
perdition? Quant au clou de
l’exposition, amis lecteurs, eh bien, c’est à première vue un vrai clou, en
allemand «Nagel», aussi titre de
l’oeuvre, quoique, la dépouille de cheville qui en coiffe la pointe comme une
sorte de préservatif dont on aurait abusé, me fasse plutôt songer à une
vis. Mais, quelle importance!? La beauté cruelle, pour ainsi dire minérale, de
cette composition sculptée, ravinée et décapée par le vent, le soleil, le
chaud, le froid et les embruns salins, en un mot, par les forces la nature qui,
avec le temps, finissent toujours par vaincre l’oeuvre des hommes, cette beauté
donc, saisie par Gerd Marx, est extraordinaire.
Hyperréalisme? Sans doute, le terme est amplement
justifié. Il arrive cependant que les
extrêmes se frôlent, se touchent même. Aussi, les créations de Gerd Marx s’éloignent
à tel point d’une vision, disons, normale, qu’en n’y regardant pas de trop
près, donc au premier coup d’oeil, certaines de ses photographies donnent
l’impression d’être abstraites. Il en
résulte des tableaux d’une beauté à couper le souffle et qui mériteraient
d’être exposés dans tout musée d’art contemporain qui se respecte. À ne pas rater!
[1] Galerie d’Art
Michel Miltgen, 32 rue Beaumont, Luxembourg centre, ouvert mardi à vendredi
10-12,30 h & 14-18 h / samedi 9,30-12,30 h & 14-18 h.- Expo jusqu’au
8 novembre